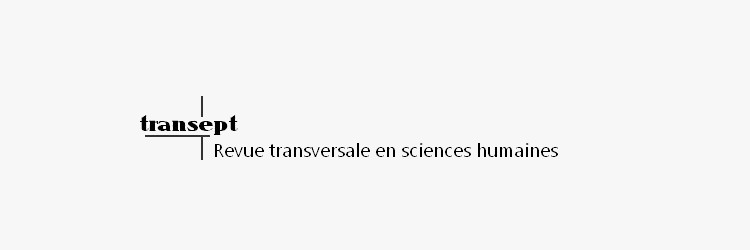De la représentation de la folie au questionnement spéculaire des rapports entre écriture et réalité dans "Le Journal d'un fou" de Nicolas Gogol (1843)
 |
| Photo : Gabriel Seigner |
Le topos de la folie, d’arrière plan-cliché de l’imaginaire populaire des romans noirs ou d’objet formel d’étude psycho-physiologique du Réalisme, devient, dans la seconde moitié du xixe siècle, l’enjeu formel même du discours littéraire. L’intérêt naturaliste d’expérimentation de la folie, comme objet d’étude froide au sein du récit, se déplace ainsi dans l’énonciation même de celui-ci, dans l’acte littéraire. « Le Journal d’un fou[1] » de Gogol semble être le premier écrit à présenter cette spécificité expérimentale. Cette nouvelle, provenant du recueil des Nouvelles de Pétersbourg (1843), met en scène, ainsi que ces autres nouvelles pétersbourgeoises, un individu, ici Poprichtchine, typiquement gogolien, isolé d’un monde incompris et incompréhensible, écrasé par un déterminisme social perçu comme absurde, reclu aux marges de la cité, aux marges d’un Saint-Pétersbourg monstrueux. Véritable mythe romantique de la modernité russe, comme triomphe de la civilisation russe, au début du siècle, Saint-Pétersbourg est ici au contraire présenté par le récit de Gogol comme emblème d’une modernité représentée comme dépersonnalisante ; artificielle, elle arrache l’homme russe à sa Terre et à son Histoire, et l’isole dans une profonde solitude, sociale comme métaphysique. Poprichtchine est donc l’isolé, l’insignifiant, à qui tout échappatoire est refusé. Enfermé en lui-même, il tient un journal, par lequel nous assistons sa plongée dans la folie, et, au-delà duquel, nous voyons, par la subjectivité imposée par le genre diariste, les spécificités même de cette subjectivité énonciative. Seul moyen d’accéder pleinement à son être, Poprichtchine y expérimente indirectement sa subjectivité propre, et par ce décalage produit par l’écriture entre le réel et sa subjectivité, la folie ne devenant pour lui que le seul moyen d’habiter paradoxalement le monde.
Ainsi, dans quelle mesure, dans cette nouvelle, cette subjectivité énonciative d’un discours de fou amène spéculairement à l’expérimentation des rapports de la littérature avec la réalité ?
C’est ce que nous verrons en étudiant les spécificités de la subjectivité énonciative du genre diariste, le subjectivisme comme posture existentiel qui en résulte et, par là, la représentation et l’expérimentation de la folie dans son rapport avec le réel intrafictionnel. Nous verrons enfin, que cette expérimentation intrafictionnelle de la folie induit nécessairement une spécularité du matériau littéraire, la nouvelle ne faisant sens que par elle-même.
⁂
Il conviendra dans un premier temps d’analyser les spécificités formelles de ce récit. Le Journal d’un fou, comme son nom l’indique, est en effet composé comme un journal intime, tenu chronologiquement par Poprichtchine. Le récit, par son genre même, est ainsi fermé à toute objectivité extradiégétique, ne passant que par la subjectivité de son personnage ; celui-ci se chargeant par là de la narration, qui plus est différée par la latence de l’écriture diariste, il devient prisme et relai intradiégétique du récit. C’est ainsi que le cadre intradiégétique, la réalité intrafictionnelle, Saint-Pétersbourg, ne dépend plus que de la subjectivité du personnage-narrateur.
Saint-Pétersbourg, nous l’avons évoqué, représente pour les écrivains romantiques russes un véritable mythe – mythe impérial dès le xviiie siècle, dont les poètes officiels louent la massivité monumentale de la ville nouvelle, le triomphe de la civilisation russe jaillissant de sa terre, devenant comme, après le poème de Pouchkine, Le Cavalier de bronze, en 1833, « le symbole du rempart contre les éléments », la « digue-rempart contre le flot, contre la rapine, contre l’invasion »[2], proclamée par le poète comme étant une « fenêtre sur l’Europe ». Cependant, ce qui faisait le triomphe symbolique de Saint-Pétersbourg devient chez Gogol, à l’inverse, le lieu de toutes souffrances existentielles. La ville chez Gogol devient en effet le lieu de privation de la Terre natale, de l’être russe, de la privation de soi – souffrance qu’il exprime dans un article publié dans la revue de Pouchkine, Le Contemporain, affirmant que Saint-Pétersbourg a « quelque chose d’une colonie européano-américaine : tant il y a peu de caractère national, et beaucoup d’amalgame étranger »[3]. Saint-Pétersbourg, par son artificialité, incarne ainsi pour Gogol la modernité : la perte d’identité, d’Histoire, de culture propre, et donc, la perte de soi, ontologique et géographique, dans la ville présentée sous le signe maléfique de Caïn, le fratricide, dans la première évocation qu’il fit de la ville dans son œuvre : « Le forgeron volait toujours ; et soudain il aperçut Saint-Pétersbourg qui scintillait, toute ruisselante de feux. » (La Nuit de Noël) Ce mythe d’une modernité déstructurante se retrouve dès lors dans Le Journal d’un fou, dans la représentation d’une société artificialisée.
La société, dans le cadre intrafictionnel, est ainsi réduite à sa simple dimension formelle et sociale dépersonnalisante. Toutes relations sociales, dans cet univers, sont réduites au simple grade hiérarchique et à la simple posture sociale. C’est le cas, par exemple, dans les relations entre les différents protagonistes de la nouvelle : ceux-ci ne sont que définis par leur être social, dans une perpétuelle comparaison hiérarchique. Dans un milieu de petite noblesse, Poprichtchine est en effet « conseiller titulaire », fonctionnaire de 9e classe, équivalent en grade de capitaine, - et, comme par un déterminisme social absolu, il n’est réduit par son entourage qu’à son propre grade. De là, de sa discorde avec son chef de section ne résulte qu’une interprétation de posture hiérarchique : « Mais je crache sur lui ! La belle affaire qu’un conseiller aulique ! » (« 6 novembre. ») – la fonction de conseiller aulique correspondant à un statut de fonctionnaire de la 7e classe et à un grande de lieutenant colonel – et, la préférence de la fille du directeur pour un certain Tieplov n’est ainsi perçu par Poprichtchine comme le seul fait de sa posture sociale plus élevée, celui-ci étant « gentilhomme de la chambre », titre honorifique de cour de 5e classe. Et c’est ce déterminisme social qui régit les relations hiérarchiques – relations ne prenant forme que par une volonté de domination, reproduite à tous les niveaux de cette hiérarchie ; ainsi, tel Poprichtchine se fait malmener par son chef de section, tel il reproduit lui-même ce mépris social sur inférieur à lui, comme ici, à propos d’un valet : « Sais-tu bien, esclave stupide, que je suis un fonctionnaire de noble origine ? » (4 octobre.)
Les relations humaines n’étant ainsi régies que par un système hiérarchique, celles-ci sont impossibles. C’est l’humain en lui-même qui est nié :
C’est une véritable caserne ! Il y vit toutes les espèces de gens : des cuisiniers, des voyageurs ! Et les fonctionnaires de mon espèce y sont entassés les uns sur les autres comme des chiens ! (« 3 octobre. ») ;
et toutes figures d’altérité deviennent ainsi suspectes aux yeux de Poprichtchine, comme intrus, ennemi : que ce soit le caissier juif (« 3 octobre »), Mavra, sa domestique, « [cette] idiot[e] de Finnois[e] » (« 12 novembre »), ou encore, son directeur, qu’il démasque être un franc-maçon, car, « quand il tend la main à quelqu’un, il n’avance que deux doigts » (« 3 décembre ») – dans tout ce que la franc-maçonnerie peut susciter comme méfiance par la teneur secrète et influente de son organisation –, etc.
En outre, l’univers fictionnel de la nouvelle n’est qu’incommunicabilité ; que ce soit par exemple avec son directeur :
J’ai essayé plusieurs fois d’engager la conversation avec Son Excellence, mais, sacrebleu, ma langue a refusé tout service : j’ai juste dit qu’il faisait froid ou chaud dehors, je n’ai positivement rien pu sortir d’autre ! ( « 11 novembre. »),
ou encore avec la fille de celui-ci, pour qui Poprichtchine cultive une certaine attirance :
Elle m’a adressé un petit salut, et m’a dit : « Papa n’est pas là ? » (…) « Votre Excellence, ai-je voulu dire, ne me punissez pas, mais si c’est là votre bon plaisir, châtiez-moi de votre auguste petite main. » Oui, mais, le diable m’emporte, ma langue s’est ambarrassée, et je lui ai répondu seulement : « N…non. » (« 4 octobre. »).
La plupart des paroles sont, dans cet univers, réduits à leur prosaïque fonction communicative. Seules les chiennes – dont l’effet d’animalisation sociale est évident – entretiennent, par leur correspondance épistolaire, un lien dialogal dans la nouvelle – et c’est de cet échange seulement que Poprichtchine peut escompter apprendre quelque chose sur lui, par les paroles rapportées et retranscrites des maîtres de ces chiennes dans cette correspondance, à défaut de pouvoir le déduire d’échanges sociaux, dont il est privé de par la profonde solitude à laquelle il est socialement condamné. Nous reviendrons plus tard sur ce déterminisme social imposé par l’autre.
Cette réalité intrafictionnelle dépersonnalisante est toutefois perçue par le prisme de la subjectivité même du personnage-narrateur. Ainsi, comme à l’image de deux miroirs l’un en face de l’autre, et reprenant par là le principe naturaliste de la causalité milieu – individu, cette réalité intrafictionnelle est représentée dans sa dépersonnalisation par la subjectivité de Poprichtchine, qui, à la fois cause et conséquence de cette représentation, est elle-même dépersonnalisée. L’individu est enfermé dans sa subjectivité, coupé du réel par celle-ci, comme le récit l’est de toute objectivité par son instance narrative intradiégétique.
Ainsi, le réel n’est représenté que par les perceptions de Poprichtchine, et, de sa subjectivité isolée du réel comme son être social l’est du monde, le principe d’identification au réel perd son sens. Par Poprichtchine, c’est toute l’absurdité du monde moderne qui s’offre à nous par une narration dépersonnalisée. Celui-ci ne confère aucun sens à sa vie, à son travail : « Je ne vois pas l’intérêt qu’il y a à travailler dans un ministère. Cela ne rapporte absolument rien. » (« 3 octobre. »), – d’ailleurs nous n’apprenons rien sur la nature de son travail, si ce n’est la récurrence de l’action de « tailler des plumes », insignifiance énigmatique, incarnation même d’un travail essoré de toute transcendance personnelle dans un univers bureaucratique oppressant et dépersonnalisant - un univers qu’il ne comprend pas, qu’il ne perçoit que par fragments, par détails synecdochiques. Cela se retrouve notamment dans la perception des autres individus, réduits aux détails de leur apparence sociale : ainsi le conseiller aulique ne l’est que par les accessoires qu’il porte (« Il accroche une chaîne d’or à sa montre à sa montre, il se commande des bottes à trente roubles… et après ? » (« 6 novembre)), et le gentilhomme de la chambre n’est présenté que par ses « favoris noirs » (« 13 novembre), etc. Les individus sont ainsi morcelés dans la perception de Poprichtchine, comme son esprit l’est dans les perceptions qu’il a du monde.
C’est cette même fragmentation de la perception que l’on retrouve dans la représentation subjective de Pétersbourg. Le monde social n’est pour Poprichtchine que « brouillard » (« An 2000. 43e jour d’Avril. »), et la ville n’est présentée que par fragments, par rues. Seules scènes d’extérieur dans le récit, les rues, d’ailleurs, sont désertées (« 3 octobre »), et la simple idée d’une promenade désintéressée est impossible, que ce soit à cause de la pluie (« 3 octobre »), de l’ « odeur de chou » de la rue des Bourgeois, ou encore à cause de « ces coquins d’artisans » qui « laissent échapper de leurs ateliers une si grande quantité de suie et de fumée qu’il est décidemment impossible de se promener par ici » (ibid.). L’espace, d’illisible, devient incohérent : ainsi Poprichtchine suit-il les dames et leurs chiennes le 3 octobre, les voit monter au quatrième étage, et cependant, se rendant chez elles le 12 novembre, il dit parvenir jusqu’au cinquième étage.
Se corrélant avec une incohérence et un flou spatial, la déstructuration temporelle est aussi présente dans le récit. Que ce soit dans la nature même du journal intime, où les faits narrés semblent plus se réaliser au moment même de l’écriture, où dans la temporalité interne de ce qui est narré ; les évènements retranscrits par Poprichtchine frappent en effet par leur monotonie oppressante. Chaque jour, du moins avant de le stade aigu de la maladie ne se déclare, ne se construit que sous la même dynamique : il se rend sans conviction à son travail, ignoré, et ne fait qu’y « tailler ses plumes ». La temporalité y est abolie, indépendante de quelconques horaires, rien ne structurant ses journées, sortant un jour à quatre heures, et devant, un autre, attendre qu’un valet le congédie. Aussi la plupart de ses journées se terminent-elles pour lui, allongé sur son lit, dans une perte totale de la perception du temps : « Je suis sorti à quatre heures. (…) Après le dîner, je suis resté étendu sur mon lit presque tout l’après-midi. » (« 9 novembre »).
Passif de sa propre vie et de la réalité, il n’essaye qu’à peine de donner à celle-ci, dans toute son absurdité, sens. Ainsi ne s’étonne-t-il pas plus que ça d’entendre parler les chiennes : « J’avoue que j’ai été stupéfait en l’entendant parler comme les hommes. Mais plus tard, après avoir bien réfléchi à tout cela, j’ai cessé de m’étonner. » (« 3 octobre »). Pire encore, il donnera leur propre sens à ses perceptions faussées :
Il y a longtemps qeue je soupçonne que le chien est beaucoup plus intelligent que l’homme. Je suis même persuadé qu’il peut parler mais qu’il y a en lui une espèce d’obstination. C’est un remarquable politique : il observe tout, les moindres pas de l’homme. (« 11 novembre »)
Le récit, par-là pathétique, ne se construit ainsi que sur cette subjectivité close et dépersonnalisée de Poprichtchine : la réalité intrafictionnelle, fragmentée et insane, est ainsi relativisée dans le subjectivisme même du personnage-narrateur. Celui-ci est ainsi coupé du monde par ce subjectivisme même, le monde est inaccessible dans son objectivité pleine, dans son essence. Seul le regard de l’Autre – que ce soit par la correspondance des chiennes ou par les réactions de sa bonne – permet à Poprichtchine de prendre conscience de lui-même, dans toute la désillusion et la frustration que cela lui provoque. Coupé de la réalité, donc, celui-ci, ne peut accorder sa subjectivité à l’ensemble normatif des différentes subjectivités pour tenter d’apprécier le réel, de l’accepter, et semble préférer le solipsisme d’une subjectivité poussé au délire. Et cela, car le réel est à fuir, et la condition sociale de Poprichtchine n’est pas acceptée ; obsédé par la condition nobiliaire, par cette hiérarchie sociale – ce en quoi ce personnage n’est aucunement, en soi, subversif, et chérissant plus qu’il ne critique ce système social-là, apparaît foncièrement antipathique – celui-ci rêve donc de puissance sociale :
Je suis noble. Je peux monter en grade, moi aussi. Pourquoi pas ? Je n’ai que quarante-deux ans : à notre époque, c’est l’âge où l’on commence à peine sa carrière. (« 6 novembre. »),
On se procure une modeste aisance, on croit l’atteindre, et un gentilhomme de la chambre ou un général vous l’arrache sous le nez. (…) Ce n’était pas pour obtenir sa main et autres choses de ce genre que je voulais devenir général. Non, si je voulais être général c’était pour les voir s’empresser autour de moi, se livrer à tous ces manèges et équivoques de courtisans, et leur dire ensuite : « Vous deux, je vous crache dessus ! » (« 13 novembre. »).
Les différents moyens de s’échapper de ce réel que Poprichtchine exècre sont de plus présentés dans leurs entraves. L’Ailleurs est impossible. Qu’il soit de l’ordre sentimental ou sexuel, par son fantasme pour la fille du directeur, seule échappée possible de son esprit par sa ressource érotique et le contact charnel avec l’Autre, seule échappée imaginative :
J’aimerais jeter un coup d’œil dans son salon, dont la porte est quelques fois ouverte, et dans la pièce qui est derrière. (…) J’aimerais entrer une seconde là-bas, dans le coin où demeure « Son Excellence » ; voilà où je désirerais pénétrer : dans son boudoir. Comment sont disposés tous ces vases et tous ces flacons, ces fleurs qu’on a peur de flétrir avec son haleine, ses vêtements en désordre, plus semblables à de l’air qu’à des vêtements ? Je voudrais jeter un coup d’œil dans sa chambre à coucher… Là, j’imagine des prodiges, un paradis tel qu’il ne s’en trouve même pas de pareil dans les cieux. Regarder l’escabeau où elle pose son petit pied au saut du lit, la voir gainer ce petit pied d’un bas léger blanc comme neige… (« 11 novembre. »)
Cependant, les interdits sociaux semblent se retrouver – et tout fantasme, tout rêve, toute correspondance de la réalité sont interdits, comme surveillés par une instance supérieure répressive qui interdirait tout élan de l’esprit et manifesté par les « Aïe ! aïe ! aïe !... c’est bon, c’est bon… Je me tais. » systématiques et avortant tous ces possibles élans – et qui, de plus, ne sont pas sans rappeler les coups de bâtons que Poprichtchine recevra à l’asile lors de ses fabulations.
L’érotisme et le fantasme sont ainsi bannis – et une forte libidinalité frustrée se dégage ainsi de ce texte. Ainsi Poprichtchine se dit-il : « Quels fripons nous sommes, nous autres, fonctionnaires ! (…) Qu’une dame en chapeau montre seulement le bout de son nez, et nous passons infailliblement à l’attaque ! » (« 3 octobre. »), alors qu’il croise, indifférentes, des passantes et, qu’apercevant la fille du directeur descendre de la calèche de son père, il s’ « effac[e] contre la muraille », se « dissimul[ant] du mieux qu[’il] pouvai[t] ». Poprichtchine est ainsi comme castré – et ce topos de la castration se retrouve au travers du motif gogolien du nez, dont l’allusion phallique semble évidente. Synecdoque du désir de l’homme, le nez, comme il en est cas dans la nouvelle éponyme de ce recueil où il est déplacé sur le corps de son propriétaire, est significativement utilisé pour accentuer les entraves du désir de Poprichtchine ; ainsi, voulant récupérer la correspondance des chiennes Medji et Fidèle, manque de peu de se faire mordre son nez par cette dernière (« 12 novembre »), ou encore, alors que la fille du directeur laisse tomber son mouchoir au sol : « Je me suis précipité, ai glissé sur ce maudit parquet et peu s’en ai fallu que je me décolle le nez » (« 4 octobre »). Synecdoque du désir érotique, donc, mais aussi, plus largement, désir en soi, comme il en est le cas dans un des délires de Poprichtchine, le nez devenant dès lors désir d’ailleurs : « Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas voir nos nez : ils se trouvent tous sur la lune. » (« Madrid, 30 février »), opposé à la pesanteur du monde moderne : « la terre, matière pesante, pouvait réduire pouvait réduire nos nez en poudre en s’asseyant dessus » (ibid.). Et, dès lors, en plus du fantasme érotique, c’est toute échappée imaginative qui semble impossible dans l’univers fictionnel, et notamment la culture. Poprichtchine est ainsi privé de littérature, de connaissance :
Tout son cabinet est garni de bibliothèques pleines de livres. J’ai lu les titres de certains d’entre eux : tout cela, c’est de l’instruction, mais une instruction qui n’est pas à la portée d’hommes de mon acabit (…). (« 4 octobre »),
et les seuls contacts culturels qu’il peut avoir sont grotesques – à l’image des pièces de théâtre populaire et de vaudeville auxquelles il assiste, ancrées dans le prosaïsme d’une réalité sociale, ne reproduisant que cette réalité qu’il exècre, et, sans aucune subversion à l’ordre établi, ne pouvant donc qu’être autorisées par la censure russe :
Je suis allé au théâtre. On jouait Filatka, le nigaud russe. J’ai beaucoup ri. Il y avait aussi un vaudeville avec des vers amusants sur les avoués, et en particulier un enregistreur de collège ; ces vers étaient vraiment très libres et j’ai été étonné que la censure les ait laissés passer ; quant aux marchands, on dit franchement qu’ils trompent les gens et que leurs fils s’adonnent à la débauche et se faufilent parmi les nobles. Il y avait aussi un couplet fort comique sur les journalistes ; on y dit qu’ils aiment déblatérer sur tout, et l’auteur demande la protection du public. Les écrivains sortent aujourd’hui des pièces bien divertissantes. (« 8 novembre ») ;
ou encore lorsqu’il récite des vers d’une stéréotypie pseudo-romantique et d’une pauvreté extrêmes, les attribuant à Pouchkine :
Une heure
passée loin de ma mie
Me dure
autant qu’une année.
Si je dois
haïr ma vie,
La mort m’est plus douce, ai-je clamé (« 4 octobre »).
Ainsi, cette réalité détestable et dépersonnalisante, où tout vecteur d’échappée est proscrit, où le déterminisme social écrase l’individu, semble fatale, inévitable. Cependant, de par les spécificités du subjectivisme prismatique de Poprichtchine, c’est dans le décollement radical de celui-ci à toute immanence imposée du réel, que le personnage-narrateur semblera trouver le seul biais possible pour échapper à cette réalité rejetée. Et la subjectivité extrême de Poprichtchine de devenir solipsisme délirant, devenant folie.
Il serait difficile de trancher quant au moment où, dans le récit, le plein basculement dans la folie de Poprichtchine se réalise. Nous l’avons vu, celui-ci est un inadapté, un frustré dont la subjectivité est exacerbée, et renvoyant, selon l’image de deux miroirs face-à-face, la déformation d’un monde moderne lui-même dépersonnalisant. Cependant, c’est après le « 8 décembre » que, formellement, physiologiquement, se déchaîne le délire total. Au-delà du récit délirant qui est retranscrit dans les différents jours du journal, c’est, méta-narrativement, la temporalité même du journal qui est abolie - dans son ancrage chronologique et dans la logique temporelle même : « An 2000. 43e jour d’avril », « Pas de date. Ce jour-là était sans date » ; dans le lexique, par l’altération des mots : « 86e jour de Martobre » ; et, enfin, acmé de la folie, dans la sémiotique même du langage comme signe, sécession ultime avec le monde : « Jo 34e ur Ms nnaée. ɹǝıɹʌǝℲ 349 ».
De plus, l’aigreur de Poprichtchine, sa méfiance systématique de l’étranger, sa frustration érotique – en soit le principe même de l’Autre – semble se transformer en une violente crise de délire de persécution paranoïaque, évoquant des « machinations de nos ennemis » (« 86e jour de Martobre. Entre le jour et la nuit. »), considérant que l’ambition des « pères de famille gradés » résulte du fait qu’ « ils ont sous la luette une vésicule qui contient un vermisseau de la grosseur d’une tête d’épingle » (ibid.), que le « barbier de la rue aux Pois », « de source certaine », « veut, avec l’aide d’une sage femme, répandre le mahométisme dans le monde entier » (ibid.), et allant jusqu’à prendre des allures pseudo-métaphysiques, d’obsession diabolique :
Oh ! Quelle créature rusée que la femme ! C’est seulement maintenant que j’ai compris ce qu’est la femme. Jusqu’à présent, personne ne savait de qui elle est amoureuse : je suis le premier à l’avoir découvert. La femme est amoureuse du diable. Oui, sans plaisanter. Les physiciens écrivent des absurdités, qu’elle est ceci, cela… Elle n’aime que le diable. Voyez là-bas, celle qui braque ses jumelles de la loge du second rang. Vous croyez qu’elle regarde ce personnage bedonnant décoré d’une plaque ? Vous n’y êtes pas, elle regarde le diable qui se tient debout derrière lui. Tenez, le voilà qui se dissimule sous son habit. Il lui fait signe du doigt ! Et elle l’épousera. Elle l’épousera ! (Ibid.)
Se corrélant à une perte totale de toute temporalité, de toute spatialité, ce délire de persécution diabolique et cette auto-persuasion manifestée de détenir une révélation propre, se rattachent, par la précision symptomatologique de leur représentation, à une violente paraphrénie – paraphrénie qui atteint son acmée lorsque Poprichtchine affirme être « le roi d’Espagne ».
Cependant, au-delà d’un certain réalisme développé dans la représentation de la folie de Poprichtchine, c’est dans le rapport même qu’entretient cette folie avec la réalité intrafictionnelle que le récit prend tout son intérêt. La folie est ainsi présentée comme une relecture du réel, comme le subjectivisme de Poprichtchine poussé au solipsisme relativisant. La crise de folie de celui-ci ayant déclanchée justement par une rupture de son subjectivisme, par le déterminisme imposé de l’Autre, lorsqu’il apprend la réelle perception que la communauté sociale a de lui, au travers de la correspondance des deux chiennes :
« (…)
Ah ! ma chère, si tu voyais cet avorton !... »
Qui cela
peut-il être ?...
« Il a un nom de famille très
bizarre. Il reste assis toute la journée à tailler des plumes. Ses cheveux
ressemblent à du foin. Papa l’emploie toujours pour faire des commissions… »
On dirait
que c’est à moi que ce vilain chien fait allusion. Où prend-il que mes cheveux
ressemblent à du foin ?
« Sophie ne peut se retenir de rire quand elle le regarde. » (« 13 novembre. »),
ravivant par là sa frustration sociale, la portant à son paroxysme lorsqu’il apprend que Sophie, comme le désire son père, ne pourrait se marier que « soit à un général, soit à un gentilhomme de la chambre, soit à un colonel » (Ibid.) De-là s’ensuit une certaine crise ontologique, une remise en cause existentielle, par laquelle tous les codes sociaux sont relativisés, leur déterminisme, et par là, le réel lui-même par un solipsisme considéré comme seule réalité valable :
Il est gentilhomme de la chambre, et après ? Ce n’est qu’une distinction : ce n’est pas une chose visible qu’on puisse prendre dans ses mains. (…) Pourquoi suis-je conseiller titulaire, et à quel propos ? Peut-être que je suis comte ou général et que j’ai seulement l’air comme ça d’un conseiller titulaire ? Peut-être que j’ignore moi-même qui je suis. Il y en a de nombreux exemples dans l’histoire : un homme ordinaire, sans parler d’un noble, découvre subitement qu’il est un grand seigneur, ou un baron ou quelque chose d’approchant. Si un illustre personnage peut sortir d’un moujik, que sera-ce s’il s’agit d’un noble ! Si, par exemple, je descendais dans la rue en uniforme de général : une épaulette sur l’épaule droite, une autre sur l’épaule gauche et un ruban bleu ciel en écharpe ? Sur quel ton chanterait alors ma dame ? Et que dirait Papa, notre directeur ? (…) Est-ce que je ne peux pas, à l’instant même…, être promu général-gouverneur ou intendant, ou quelque chose de ce genre ? Je voudrais savoir pourquoi je suis conseiller titulaire ? Pourquoi précisément conseiller-titulaire ? (« 3 décembre. »)
Le basculement schizophrénique
dans la folie prend donc une valeur existentielle. Et, d’une étrange obsession
causée par l’actualité politique, la question problématique de la succession au
trône d’Espagne – dont le choix de l’Espagne n’est pas sans signifier cette
idée d’ailleurs idéal, loin d’un
Saint-Pétersbourg oppressant et dépersonnalisant, l’Espagne allant, dans un de
ses délires, jusqu’à être associée à la Chine – provient le délire ultime de
Poprichtchine, se considérant comme « roi d’Espagne ». Revanche sur
le déterminisme social de son être, la folie est ainsi pour lui le seul moyen
de s’en échapper, le seul ailleurs possible :
« Tout ceci vient, je crois, de ce que les gens se figurent que le cerveau
de l’homme est logé dans son crâne : pas du tout : il est apporté par
un vent qui souffle de la mer Caspienne. » (« An 2000. 43e
jour d’avril ») ; le seul moyen de transformer, par l’altération des
perceptions causées par la maladie, le réel. Ainsi l’asile où il est interné
devient l’Espagne, les infirmiers, les « députés », les coups de
bâtons que ceux-ci lui donnent, « un rite de la chevalerie » ou des
« coutumes populaires » espagnoles, ou encore l’aliéniste, un
« chancelier » puis « le Grand Inquisiteur en
personne » ; ou encore, lors de sa dernière irruption dans son lieu de
travail, lorsque l’impression que cause aux autres sa folie est réinterprétée
selon la logique de son délire : « Il fallait voir le silence
respectueux qui a régné alors. », après qu’il ait annoncé être
« Ferdinand VIII », par exemple, etc.
De cette relecture soliptique et délirante du réel naît ainsi une certaine dimension carnavalesque. Par la folie de Poprichtchine, c’est le monde qui est renversé, inversé : lui, le moins-que-rien, devient roi, l’autorité du directeur est bafouée (« Qu’est-ce que c’est qu’un directeur ? Que je me lève devant lui ? Jamais ! », « 86e jour de Martobre… ») – et les codes sociaux sont transgressés, Poprichtchine allant jusqu’à pénétrer de force dans l’appartement du directeur et refusant de travailler : « On a placé des papiers devant moi, afin que j’en fasse le résumé. Mais je ne les ai même pas effleurés du bout des doigts. », ibid.) Dimension carnavalesque, donc, comme une farce intrafictionnelle – dont les allusions aux pièces de théâtre populaires auxquelles Poprichtchine assiste en deviennent la mise en abyme. Dimension farcesque qui pourrait encore se retrouver, par exemple, dans la récurrence de la bastonnade, à l’asile, notamment. Poprichtchine est ainsi bouffonnant, et de ce décalage carnavalesque causé par sa folie, vu par le prisme de sa folie, naît une certaine dimension comique. Poprichtchine lui-même se rend, persuadé d’être roi, au ministère « pour rire ». L’ordre social est ainsi implosé, transgressé par le rire fou.
La folie retrouve ainsi, dans ses modalités de représentation, et dans les spécificités de sa teneur dans ce récit, sa pleine valeur existentielle : la mise a distance du monde, sa relecture idéaliste. Et c’est par là que naît le rire fou : par le prisme de la folie, la réalité sociale se dessine en négatif dans toute sa vilénie, dans la vanité de ses codes, de ses hiérarchies, de sa cruauté. Le carnaval semble le seul moyen pour réécrire le monde, créer un monde propre, adapté à un moi bafoué par la modernité.
Aussi, le récit d’une plongée dans la folie comme échappatoire à un Saint-Pétersbourg monstrueux prend ainsi un tout autre sens si l’on considère séculairement le matériau-récit en lui-même. Retranscrire le discours d’un fou, imposé par le genre même du journal, c’est amener la folie dans l’énonciation du récit ; et, par les questionnements que soulèvent le traitement de cette folie, par les rapports entre réalité et subjectivité, c’est la littérature qui, dès lors, semble se penser réflexivement dans son propre rapport au réel, dans sa dimension fantastique.
A propos de l’œuvre de Gogol, Mérimée dira : « Il tient de Téniers et de Callot. Malheureusement, tout absorbé par cette étude minutieuse de détails, M. Gogol néglige un peu trop de les rattacher à une action suivie. », et Gogol de reconnaître la spécificité de sa littérature :
Non, cela ne tient pas debout, je ne le comprends
absolument pas… Mais ce qu’il y a de plus étrange, de plus extraordinaire,
c’est qu’un auteur puisse choisir de pareils sujets… Je l’avoue, cela est, pour
le coup absolument inconcevable, c’est comme si… non, non, je renonce à
comprendre. Premièrement, cela n’est absolument d’aucune utilité ;
deuxièmement… mais deuxièmement non plus, d’aucune utilité ! (Le Nez)
« Le Journal d’un fou », en effet, ne semble en réalité être qu’un non-récit, sans action autre la plongée révoltée de Poprichtchine dans la folie, et les manifestations de celles-ci, tout l’intérêt venant, nous l’avons vu, des spécificités de la représentation de cette folie. Contrairement à ce qu’annonce Poprichtchine en début de nouvelle : « Il m’est arrivé aujourd’hui une aventure étrange. », il n’y a donc aucune autre dynamique d’action que celle de sa folie – tout l’intérêt formel de cette nouvelle venant dès lors, par cette superposition de folie – littérature, dans la dynamique expérimental même du récit. L’ « aventure étrange » qu’évoque le narrateur est en réalité l’aventure du récit même.
Cela se verrait notamment dans l’identification que l’on pourrait relever de Gogol envers son personnage, Poprichtchine. Ce dernier, en effet, ayant vécu un certain temps à Saint-Péterbourg, a mal vécu ce séjour : ville artificielle et déracinante, espace de souffrance et de violence, celle-ci devient, nous l’avons dit, par l’œuvre de Gogol, le mythe d’une modernité russe en perdition, une dénégation de l’homme et de l’Histoire russe. Et, devenant dans son oeuvre telle qu’elle est représentée dans la nouvelle, la ville de Saint-Pétersbourg fut pour Gogol « le catalyseur de [son] aliénation »[4], ressentant la même angoisse et le même désir de fuite vers un ailleurs fantasmatique que son personnage :
Il fait bon méprise cette vie sédentaire et rêver d’évasion vers d’autres cieux, vers des bosquets méridionaux, des contrées à l’air neuf et frais. Il fait bon entrevoir au bout de l’avenue pétersbourgeoise les hauteurs ennuagées du Caucase ou les lacs d’Helvétie ou l’Italie couronnée de laurier et d’anémone, ou la Grèce somptueuse dans sa nudité… Mais halte-là, ma pensée ! Ne suis-je pas encore tout entouré et écrasé par les bâtisses de Pétersbourg ? (article publié dans Le Contemporain)[5].
Poprichtchine semble alors figurer l’auteur lui-même, ou, au-delà, l’auteur comme être social, inadapté dans la modernité russe, et pour qui, au travers la spécularité du récit d’un fou, comme le fou choisit de raconter sa folie, choisit la littérature, la subjectivité de la littérature, comme médium de relecture du monde par son potentiel fantastique. C’est ainsi ce pouvoir là de la littérature qui est expérimenté dans ce récit : comme Poprichtchine rejette le monde par sa folie, la littérature, spéculairement, par sa création propre, le rejette par la représentation de cette même folie.
Toutefois, comme la folie de Poprichtchine, la littérature aussi semble se buter à son plein pouvoir fantasmatique. Celui-ci en effet, malgré sa folie, voit surgir dans sa subjectivité l’immanence de la réalité : les coups de bâtons assénés par les infirmiers et le docteur de l’asile. Ainsi, à travers lui, à travers la prise de conscience qu’il a du fait que l’on ne peut jamais pleinement échapper au réel, c’est la littérature qui est ainsi affirmée dans ses limites de correspondance. La pleine transcendance vers un absolu ailleurs – qui est ici signifiée au travers du Principe originel – est présentée à la fin de la nouvelle comme impossible – et comme Poprichtchine reconnaît la limite de sa folie, la littérature, par lui, reconnaît les siennes :
Je suis à bout, je ne peux plus supporter les
tortures ; ma tête brûle, et tout tourne devant moi. Sauvez-moi !
Emmenez-moi ! Donnez-moi une troïka de coursiers rapides comme la
bourrasque ! Monte en selle, postillon, tinte, ma clochette !
Coursiers, foncez vers les nues et emportez-moi loin de ce monde ! Plus
loin, plus loin, qu’on ne voie rien, plus rien. Là-bas, le ciel tournoie devant
mes yeux : une petite étoile scintille dans les profondeurs ; une
forêt vogue avec ses arbres sombres, accompagnée de la lune ; un
brouillard gris s’étire sous mes pieds ; une corde résonne dans le
brouillard ; d’un côté la mer, de l’autre, l’Italie ; tout là-bas, on
distingue même les isbas russes. Est-ce ma maison, cette tâche bleue dans le
lointain ? Est-ce ma mère qui est assise devant la fenêtre ?
Maman ! Sauve ton malheureux fils ! Laisse tomber une petite larme
sur sa tête douloureuse ! Regarde comme on le tourmente ! Serre le pauvre
orphelin contre ta poitrine ! Il n’a pas sa place sur la terre ! On
le pourchasse ! Maman ! Prends en pitié ton petit enfant
malade !
Cependant, malgré la reconnaissance de son échec, la littérature refuse tout pessimisme. La complainte douloureuse de Poprichtchine cesse brutalement, et celui-ci retombe dans le délire, clôturant brutalement le récit : « Hé, savez-vous que le dey d’Alger a une verrue juste en dessous du nez ? ». Ainsi, malgré l’impossibilité du plein pouvoir de transposition de la littérature sur le réel, comme du subjectivisme délirant de Poprichtchine sur une réalité immanente même dans la folie, le récit s’affirme et s’assume dès lors paradoxalement dans son pouvoir de référentialité de la réalité. La folie de Poprichtchine est ainsi, par cette simple phrase, ramené dans une illusion assumée, et la littérature, affirmée spéculairement dans la sienne : la folie comme la littérature, dès lors, ne sont plus vecteurs d’échappée au monde, mais médiums de sa représentation déformée, en négatif. Comme la folie de Poprichtchine permet d’exerguer négativement la réalité détestable de la modernité pétersbourgeoise, sa représentation carnavalesque, la littérature, par son impossible émancipation du réel, permet, elle, d’affirmer la nécessité de cette même réalité et se retranscription inévitablement déformante. Le matériau littéraire, donc, s’expérimentant dans ses possibilités de correspondance, finit par, au contraire, s’affirmer malgré lui dans son nécessaire engagement au monde. Et c’est alors que « Le Journal d’un fou », malgré lui, devient une inévitable satire sociale, de par la spécularité de son matériau littéraire même, une critique sociale de la société pétersbourgeoise, en témoignent les différentes censures qu’à subit le texte en fonction de ses rééditions.
⁂
Nous avons ainsi vu que
l’introduction de la folie, plus
qu’un simple motif littéraire, dans l’instance énonciative même amène le récit
à se concevoir spéculairement. Celui-ci, en effet, en offrant la narration à un
fou bouleverse profondément, par le subjectivisme
intrinsèque de cette narration diariste, l’acte de création littéraire en
lui-même. Ainsi associée à la folie de Poprichtchine, le matériau
littéraire s’expérimente spéculairement dans les rapports propres qu’il
entretient avec le réel, dans son principe de référentialité du réel. Par les
limites folie de son narrateur, rattrapée par l’immanence du monde, elle
réalise qu’elle ne peut pleinement faire sécession avec le réel, mais que, par
les ouvertures des possibles de représentation que permet la folie énonciative, son pouvoir est
justement dans ses capacités de possibilité de représentation. La folie énonciative devient ainsi, de
simple expérimentation littéraire, prétexte indirect à la représentation
carnavalesque d’un monde dont la référence se fait dès lors négativement. La littérature, ainsi, si
elle ne peut se passer du monde pour être,
se sait dès lors, comme un pouvoir alchimique,
capable de le déformer, de jouer avec ses représentations, en bref, de pouvoir
introduire par le récit le fantastique,
d’habiter dans le miroir du monde et du réel.
[1] Edition utilisée : Nicolas Gogol, Nouvelles de Pétersbourg, trad. Gustave Aucoutumier, Sylvie Luneau et Henri Mongault, Paris, Gallimard (coll. Folio classique), 1998.
[2] Georges Nizat, Préface des Nouvelles de Pétersbourg, op. cit., p. 9.
[3] Cité in Ibid., p. 11
[4] Georges Nizat, Préface des Nouvelles de Pétersbourg, op. cit., p. 35.
[5] Cité in Ibid., p. 11.