Le réel se présente à nous d'une manière médiate. Il se construit à travers le réseau symbolique de notre culture. Nul ne l’exprime mieux que Louis-Marie Chauvet, théologien catholique romain et professeur à l’Institut Catholique de Paris, dans son saisissant ouvrage Symbole et Sacrement. « Cet ordre symbolique désigne le système de rapports entre les divers éléments et les divers niveaux (économique, social, politique, idéologique — éthique, philosophie, religion...) d'une culture, système qui forme un tout cohérent permettant au groupe social et aux individus de s'orienter dans l'espace, de se repérer dans le temps, de se situer dans le monde de manière signifiante, bref, de s'identifier dans un monde qui a du sens[1]. »
L'ordre symbolique creuse l'écart entre la sensation et la perception. La première advient quand la réalité physique atteint les sens tandis que la seconde s'opère au travers d'une « couche sémiologique » apportée par la culture. Les signes d'une civilisation se retrouvent projetés dans le monde visible qui ne peut se présenter à nous comme purement « naturel ». L'épaisseur culturelle empêche ce dépouillement en donnant aux objets un rôle signifiant. Le monde visible n'est pas simplement passif, soumis à une simple observation par les sens; il appelle l'homme et l'invite à répondre. « Du paysage que je contemple, je ne retiens que quelques traits : ce qui de lui fait écho en moi est relatif aux avatars de mon désir et aux valeurs du système socio-culturel auquel j'appartiens, valeurs que j'ai tellement intériorisées depuis la prime enfance qu'elles m'apparaissent comme toutes naturelles[2] ». La mer que je perçois est apportée à mes sens avec ce que ma culture et mon désir en disent. Je ne la perçois pas via une analyse chimique irréductible, nue, sanctifiée de toute signification. Je la perçois comme déjà signifiante.
L'ordre symbolique constitue un pacte culturel, un pacte par lequel les hommes sont sujets. C'est hors d'une réalité régressive, polarisée et donc insignifiante que les sujets peuvent apparaître. L'homme « hérite d'un monde déjà culturellement habité et socialement aménagé, bref déjà parlé[3]. » Le sujet se construit ainsi dans l'ordre symbolique, en construisant lui-même le monde, en construisant le réel comme « monde ». Ce réel comme tel est par définition inatteignable par l'homme, incapable d'être perçu en dehors de notre « lentille langagière ».
Le langage
Nous sommes unis à cette perception symbolique. De la même manière, nous sommes unis à notre langage. Un homme dans ce monde sera toujours trouvé comme parlant, parce que c'est dans le langage qu'il se crée:
Comme le corps, le langage n'est pas un instrument, mais une médiation : c'est en lui qu'advient l'homme comme sujet. L'homme ne lui préexiste pas, il s'élabore en son sein. Il ne le possède pas comme un « attribut »; fût-il de première importance, il est possédé par lui. Le langage ne vient donc pas traduire après coup un expérience comme expérience humaine, c'est-à-dire signifiante[4].
Le langage de la création
Le langage fait notre monde. Il ne constate pas seulement l'existence des choses, il ne se borne pas à exprimer les sensations, mais porte avec lui tout un monde culturel. Ce n'est pas la simple existence d'un objet que l'homme perçoit mais sa place dans la culture. Il le fait par le langage, parlé ou non. Le paysan de Chauvet, en train d'arracher ses pommes de terre et qui s'écrie « Tiens, un ver blanc ! » ne constate pas seulement l'existence de ce ver. Il perçoit la menace de ce ver blanc et de tous ses camarades. « C'est tout son monde culturel qui est ainsi mis en mouvement à travers son exclamation. » D'ailleurs, cette exclamation aurait pu se manifester autrement, par un simple « tiens ! », une plainte discrète ou un geste de rejet du ver. Mais dans toutes ces possibilités, le sujet reste parlé/parlant, « comme il ne cesse de l'être en constatant que les pommes de terre ne sont pas trop gâtées, en entendant la voix des gens qui jardinent non loin de lui, en s'épongeant le front, en se redressant pour apaiser un léger mal de reins ou en se sentant vieillir... » Le langage est toujours présent.
La parole nous précède même. Elle frustre notre désir de toute puissance, de contrôle par le pouvoir représentatif du mot. L'homme n'utilise pas le langage, il ne s'en sert pas comme un simple instrument pour désigner ce qui se présente à lui. Non, le langage est créateur, catalyseur de la réalité. « Il fait mourir les étants dans leur simple factualité de ce qui s'étend sous nos yeux pour les faire advenir comme signifiants de l'homme et pour l'homme[5]. »
Il est d'usage de considérer la parole comme extériorisation. Le langage n'est alors qu'une simple expression de l'intérieur humain, de ce qui se tapit dans l'homme. Il manifeste ouvertement l'intériorité du sujet, il le traduit publiquement. Pourtant, « il n'est de réel humain, si intérieur ou intime soit-il que dans la médiation du langage ou du quasi-langage qui lui donne corps en l'exprimant[6] ». Autrement dit, l'intériorité et l'extériorité sont l'un dans l'autre. L'impression prend forme (devient signifiante) dans l'expression qui l'accomplit et la pensée se forme en s'exprimant.
Le sujet dans le langage
L'origine de cette puissance créatrice du langage reste cependant mystérieuse. Du côté de la linguistique, il faut commencer par reconnaître le statut particulier des pronoms personnels. Ils sont différents des autres signes puisqu'ils « ne renvoient en effet 'ni à un concept' (il n'y a pas de concept 'je' englobant tous les 'je' qui s'énoncent à tout moment), 'ni à un individu' (un même terme ne peut à la fois identifier quelqu'un dans sa particularité et en même temps se référer indifféremment à n'importe quel individu[7]) ». Ils ne signifient pas le sujet de l'énonciation mais le désignent.
Le JE est la condition de tout discours, il est à la fois contenu de l'énoncé et auteur de l'énonciation. Il n'est cependant pas envisageable sans le TU, son réversible. En outre, le rapport linguistique JE-TU ne peut exister sans la médiation d'un tiers. Il se « dégraderait en relation duelle de type spéculaire si elle ne se déployait sous l'instance tierce du monde social et cosmique[8] ». Le IL s'avère nécessaire. Dépositaire de l'impersonnel, il « permet au JE de s'ouvrir à l'universel », il embraye le JE sur l'Autre. Le JE peut alors répondre à son double rôle: « comme représenté, dans l'énoncé ; et comme présent, dans l'acte d'énonciation ».
Cette médiation tierce concède de revoir notre perception traditionnelle de la différence. Elle nous fait sortir du schème traditionnel de la distance-éloignement et nous permet alors de saisir pourquoi le TU est à la fois le plus différent et le plus semblable du JE. Percevoir la différence via une représentation distance-éloignement maltraite la différence en ne lui accordant qu'une simple valeur négative: « elle ne peut être envisagée comme lieu de la vérité ; elle ne peut au contraire être représentée que comme obstacle à la vérité, barrage à cette idéale transparence de soi à soi, à autrui et au monde qu'il faudrait tenter de reconquérir, comme expression d'une finitude pensée comme conséquence d'une primordiale chute ou d'un originel péché. Du même coup, l'altérité ne peut être qu'attribuée à une tragique altération du moi ainsi déchu[9]. » Il faut fuir cette évaluation par l'éloignement et considérer la différence comme altérité qui rend possible la communication. C'est la différence humaine où l'un n'est possible que par l'autre. C'est la différence créatrice, et non obstacle, de la vérité.
La structure triadique du langage montre ainsi que le sujet se construit par le clivage. La compréhension du développement du sujet humain par Lacan parvient à la même conclusion. Pour le psychanalyste, le petit enfant passe par le « stade du miroir » dans lequel il s'identifie à lui-même dans son reflet (via à un miroir ou face à un autre enfant). Jusqu'alors, il percevait son corps comme morcelé, fait d'éléments détachés les uns des autres. C'est l'unité qu'il perçoit dans son reflet, une unité nécessaire à la construction du sujet. Mais se contemplant, il risque, tel Narcisse, de se perdre dans son reflet, ne parvenant pas à s'en défaire.
Pour sortir de cette sur-identification à son image, il arrive un temps où l'enfant parvient à se reconnaître dans des représentants de lui. Il s'identifie à son nom propre et au pronom JE, il accède à la subjectivité. « Il faut qu'il s'entende nommé par un autre, qu'il s'entende représenté par un nom, son nom[10]. » Le nom propre et le JE ont un double rôle puisqu'ils « constituent la médiation d’avènement du sujet, dans la mesure où celui-ci y est représenté ; mais aussi et simultanément, ils constituent la médiation d'exclusion du sujet, dans le mesure où celui-ci n'est que représenté[11]. » Le sujet apparaît alors, à la fois exclu et représenté dans l'ordre symbolique du langage. La « coïncidence imaginaire de soi à soi-même » est brisée parce que « le réel est mis à distance ». Cette rupture dans le sujet est nécessaire, elle le fonde. Le clivage vient fonder l'identité du sujet en lui dévoilant ce manque dont il a besoin. Il doit consentir à ce « manque qui le constitue et qui s'ouvre en lui par le langage ».
Le sujet peut alors être envahi par l'ordre symbolique. Par la suite, cet ordre est maintenu par le deuil, le deuil du « narcissisme primaire » qui nous promet la toute-puissance et la maîtrise des choses. « L'immédiatement convoité » doit être fuit pour devenir quelqu'un, quelque un parmi d'autres ; « il faut donc renoncer à être tout, à avoir tout et tout de suite[12] ». Nous pouvons alors devenir quelqu'un d'ordre symbolique. Et vivre réellement.
C'est d'une brèche que naît le sujet, nous assurent la linguistique et la psychanalyse de Lacan. Cette brèche entre le moi et le moi représenté dans le langage, entre le « réel » et l'ordre symbolique est salvatrice pour nous. Comme sujet, nous naissons d'elle et nous maintenons en elle. Nous apprenons à nous dégager de notre attachement immédiat à nous-mêmes et à son monde originel. Nous entrons dans la médiation de l'ordre symbolique par cette brèche et en consentant à la présence du manque. « Le sujet n'est que dans un devenir permanent, dans un avènement in-fini[13]. »
L'ordre symbolique
On pourrait croire que cette entrée dans l'ordre symbolique amène l'homme sur « un chemin d'errance dans un no man's land désertique sans repères[14] ». Ce n'est pas le cas. Une loi règne dans cette ordre, une loi qui se concrétise dans le « procès d'échange symbolique » où le sujet est mis en rapport avec les autres sujets. Plusieurs traits se dégagent de ce procès mais le plus important est celui de la non-valeur.
Échange d’hier et d’aujourd’hui
Chauvet développe cette idée via le travail de Marcel Mauss sur un type d'échange dans certaines sociétés archaïques. Leur échange était d'abord un « fait social total », touchant l'ensemble des domaines (nourritures, femmes, fêtes...) et des niveaux de la société[15]. Il parvenait à traverser toute la société. Ensuite, ce type d'échange était d'ordre symbolique, il ne faisait pas circuler de l'utile. Il fuyait l'ordre du marché ou de la valeur où l’utile est roi. L'objet est donné « pour rien », en dehors d'une quelconque valeur marchande ; il est donné « pour faire la fête ou se montrer à la hauteur de leurs congénères[16] ».
Bien que ce type d'échange soit hors-valeur, il ne peut pas être considéré stricto sensu selon nos termes habituels de présent, de cadeau ou de don. En effet, dans ces sociétés, ce qui est donné oblige. Il est obligatoire de donner, car « refuser de donner équivaut à déclarer la guerre, c'est refuser l'alliance et la communion[17] ». Réciproquement, le destinataire ne peut pas refuser le cadeau. L'échange devient nécessaire des deux côtés.
Tout don reçu oblige. Impossible de prendre ce qui est offert sans rendre, et notamment à un tiers qui, à son tour, offrira son contre-don à un quatrième, etc. Si bien que les richesses circulent sans cesse du haut en bas de la société, à tous les niveaux et dans tous les domaines[18].
Il est difficile pour nous de percevoir cet ancien système d'échange. « Car, chez nous, tant de siècles de tradition métaphysique, de civilisation technique, de valeur marchande se sont écoulés, faisant régner l'équivalence, que, par un destin historialement inexorable, nos langues mêmes ont oublié l'ambivalence native de notre vocabulaire d'échange[19]. » Les générosités nécessaires, les gracieusetés obligatoires ont disparu de nos échanges. Pourtant, c'est « cela encore qui nous fait vivre comme sujets et qui structure tous nos rapports dans ce qu'ils ont d'humainement essentiel. S'il est vrai, du moins, que ce qui nous fait vivre n'est pas de l'ordre de l'utile mais de l'ordre — comme dans l'amour — de la grâce, de l'excès, du 'par-dessus le marché[20]'... »
Aujourd'hui, le cadeau est ce qui résiste le mieux au besoin de valeur. Selon Jean Baudrillard, le cadeau est proche de l'échange symbolique car indissociable de la relation, du pacte qu'il scelle entre deux individus. Parce qu'il est comme le don d'une part de soi à l'autre, il établit la présence l'un à l'autre des deux personnes et leur absence l'un à l'autre. La relation est alors ambivalente, entre deux personnes ambivalentes. Alors que l'objet signe ne renvoie qu'à l'absence de relation, l'objet-symbole établit la relation dans l'absence. Pour mieux comprendre ce qui les distingue, Baudrillard donne quatre logiques différentes de la valeur :
1) celle fonctionnelle, de la valeur d'usage, régie par l'utilité (la voiture, comme moyen de circulation rapide) ; 2) celle, économique, de la valeur d'échange, régie par l'équivalence (la voiture, comme équivalent à tant d'argent) ; 3) celle différentielle, de la valeur-signe, régie par la différence codées (la voiture, comme signe d'un certain standing ou statut social) ; 4) celle, enfin, de l'échange symbolique, régie par l'ambivalence[21].
Les trois premières logiques sont au service de la valeur tandis que la dernière est la seule à prêter sa voix à la non-valeur. Aujourd'hui c'est la logique de la valeur-signe qui règne dans notre société de consommation. La valeur des choses n'est pas définie par la valeur des choses mais par le signe qui découle de cet usage. « La production n'est plus déterminée que par les besoins idéologiques qu'elle crée : placée sous le signe de la croissance pour la croissance, sans autre finalité ni référent que le signe de prestige, de puissance, de progrès dont elle nous comble, elle ne vit que de sa propre reproduction en valeur/signe codée[22]. » Ce n'est pas tant la chose que l'idée de la chose qui nous est vendue. On nous vend moins un aliment biologique que le biologique lui-même. Le biologique d'avant ne peut être retrouvé dans notre société, le système ne peut donc que l'établir comme signe. Face à ce qui est perdu, notre société se contente d'apposer des signes.
On redouble le réel, on établit un code auquel notre système fera seulement référence. C'est « l'ordre des simulacres » de Baudrillard, un ordre où l'objet est avant tout disponible. L'homme peut prendre mais surtout, il doit prendre. Mais, contrairement aux anciennes sociétés, il ne peut rendre, il n'a pas droit au contre-don. « L'échange symbolique, articulé sur la réversibilité de l'échange, est neutralisé : travail, loisirs, confort, sécurité, information, santé physique et psychique, savoir scientifique, 'culture', tout est donné unilatéralement pour mieux inféoder au code régnant[23]. »
L’échange utile et l’échange symbolique
La valeur, l'utilité et l'immédiateté ne définissent pas l'échange symbolique alors qu'elles sont au cœur de la logique du marché. Au-delà ou au-deçà de ces principes, l'échange symbolique a pour principe l'excès. « Le véritable objet de l'échange, ce sont les sujets eux-mêmes. Par le truchement des objets, ce sont les sujets qui nouent ou renouent alliance, qui se reconnaissent comme membres à part entière de la 'tribu', qui y trouvent leur identité en s'y montrant à leur place et en mettant ou remettant les autres 'à leur place[24]'. » Les participants de l'échange se reconnaissent mutuellement comme sujets. Ils le font via ce qui est sans valeur, par le simple désir de l'autre et le concrétisent dans un « rapport d'alliance, d'amitié, d'affection, de reconnaissance[25] ».
La non-valeur de l'échange symbolique pointe vers la grâce divine. La grâce est le « non-calculable et le non-stockable[26] ». Au-delà de la logique de marché, elle est définie par l'excès. Elle est gracieuseté, elle « ne peut pas, par définition même, faire l'objet d'un calcul, d'un prix, d'un marchandage ». Elle est aussi gratuité, puisqu'elle est un don divin qui nous précède. Ces deux concepts doivent s'unir pour dévoiler la grâce dans ce qu'elle est. Si la gratuité seule est envisagée, la grâce n'apporte plus avec elle le devoir de contre-don. Ce devoir de réponse fonde habituellement la reconnaissance d'autrui comme sujet. L'interdire par une gratuité seule transforme le sujet en objet. Le sujet n'est plus reconnu comme « autre », il disparaît. « Théologiquement par conséquent, la grâce exige non seulement cette gratuité première dont dépend le reste, mais aussi la gracieuseté de l'ensemble du circuit, et notamment du contre-don[27]. » L'homme répond à la grâce divine. Croyant, il se fonde comme sujet dans un échange symbolique avec son sauveur. La grâce lui fait devenir ce qu'il doit être.
Signe et symbole
Nous avons dévoilé précédemment les deux logiques qui s'opèrent dans l'échange des biens. La logique du marché et de la valeur regarde aux objets comme tels. La logique de l'échange symbolique et de l'hors-valeur regarde au rapport entre les sujets comme tels. Ces deux niveaux, ces deux polarités en tension dialectique se retrouvent dans la distinction entre signe et symbole. Il faut cependant souligner que « signe et symbole sont toujours mêlés dans le concret[28]. »
Un peu de grec
Le mot symbole trouve sa source dans le grec symbolon à travers sa transposition latine symbolum. Il dérive du verbe symballein qui signifie littéralement « jeter ensemble ». C'est un effet l'union de l'idée d'« être ensemble », « avec » par le préfixe sym et de l'idée de mouvement par le verbe balleïn.
Le symbole antique apparaît dans le cadre d'une alliance entre deux parties. C'est un objet que l'on coupe en deux et dont on distribue chaque partie à chacun des deux partenaires. Deux personnes qui contractent ensemble un lien d'hospitalité, par exemple, se partagent une tablette brisée et conservent soigneusement chaque moitié. Seul, chaque morceau reste sans valeur mais c'est dans la réunion avec l'autre qu'il accomplit son sens. Les personnes à l'origine de ce contrat ou leurs descendants peuvent des années plus tard ajointer ces deux morceaux pour reconnaître l'alliance établie. L’emboîtement unique de chaque partie renvoie à la même alliance.
Le symbole est ainsi « l'opérateur d'un pacte social de reconnaissance mutuelle et, de ce fait, un médiateur d'identité[29] ». Cette reconnaissance n'est pas passive puisque chaque partie en appelle une autre pour une réunion qui lui donnera sa pleine réalité ; c'est le sens dynamique de balleïn. « On voit ainsi qu'il joue un double rôle : d'une part il guide et oriente la recherche de la réunion, d'autre part il garantit et certifie cette réunion lorsqu'elle a enfin été effectuée[30] ». L'antonyme grec du symbole c'est le diable (diabolos): celui qui sépare. « Dia-bolique est tout ce qui divise, sym-bolique tout ce qui rapproche[31]. » Peu à peu, la signification du mot symbolon s'étend pour désigner tout élément qui permet la reconnaissance, l'identification des individus d'un même groupe. Un symbole peut dorénavant être un objet, un mot, un geste, voire une personne.
Le langage et le symbole
Le symbole nous introduit dans un monde auquel il appartient. Il nous ouvre la porte du monde culturel dont il fait lui-même partie. Le signe, lui, se contente de renvoyer à un autre ordre que lui-même, à un monde qui lui est étranger. Il présente quelque chose d'autre que soi alors que le symbole prend pleinement part au monde qu'il symbolise.
Cette particularité du symbole se comprend bien à la lumière du phonème, degré zéro du symbole. Le phonème est un symbole, «d 'une part parce que, n'ayant aucun signifié, il ne renvoie pas à quelque chose d'un autre ordre que celui auquel il appartient ; d'autre part, parce que pourtant il introduit dans le monde du sens : il présuppose, pour pouvoir être reconnu comme phonème, une convention humaine qui l'arrache à son simple état de 'bruit' et qui le situe dans la chaîne des signifiants destinés à la communication, c'est-à-dire dans l'ordre humain, et non plus animal[32]. » Reconnaître un phonème humain au milieu des bruits de la nature, des cris des animaux, c'est discerner une présence humaine, « renouer alliance avec l'humanité. Le pacte social du symbole commence, dès l'orée du langage avec les phonèmes. » Ce pacte reste unique puisqu'il n'a eu besoin d'aucun décret de la société humaine pour s'imposer. Il l'a en fait accompagnée dès ses débuts.
Le phonème apporte la différence humaine dans le bruit de l'univers, il distingue sa communication de tout ce qui peut être entendu. À partir de ces différences, il crée un « système culturel de communication ». La distinction est aussi interne puisque « /b/ n'est un phonème que par les traits discrets qui les différencient de /p, /g/, /k/[33] ». C'est dans son rapport aux autres que le phonème, degré zéro du symbole, se construit. Le symbole n'est donc pas isolé, il a besoin des autres éléments du système pour signifier. Sa valeur est différentielle et non absolue, elle doit s'inscrire dans un rapport aux autres pour pouvoir dire quelque chose. « Tel un morceau de vase brisé, un symbole ne tient donc sa valeur que de la place qu'il occupe au sein de l'ensemble[34]. »
Le phonème porte donc avec lui tout un monde. Inséparable des autres, il renvoie à leur union quand on les rencontre. Reprenant l'illustration du morceau de vase brisé, Chauvet montre que nous associons ce morceau avec l'ensemble auquel il appartenait par « collage mental avec les autres morceaux ». Le symbole représente le tout, il entraîne avec lui l'ensemble de l'ordre socio-culturel dont il fait partie. Il fait venir son monde, l'introduit dans notre réalité.
 |
Vincent Van Gogh, Vieux Souliers aux lacets, 1886 |
Heidegger en est témoin lorsqu'il s'arrête sur les chaussures de paysanne peintes par Van Gogh. Pour lui, ces paires de souliers soulèvent tout un monde, celui des paysans.
[D]ans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur [...]. À travers ces chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau au besoin, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à l'abri dans le monde de la paysanne[35].
Un mot est considéré comme un signe quand il se cantonne à la « dimension informative » du langage, à « la justesse de la connaissance qu'il fournit[36] ». Le mot comme signe est au service de la valeur de l'énoncé. Le souci d'exactitude caractérise ce type de langage et a comme idéal le discours scientifique. Au contraire, le mot comme symbole nous montre que « la fonction première du langage n'est pas de désigner un objet ou de transmettre une information — ce que fait aussi tout langage —, mais d'abord d'assigner une place au sujet dans son rapport à autrui[37] ».
C'est ce que nous ressentons lorsqu’au milieu d'un pays étranger nous percevons le langage de notre propre pays. Quand les mots exprimés dans notre langue se détachent du bruit ambiant, nous ne nous arrêtons pas sur leur signifié mais sur le monde dont ils font partie, notre pays. Ce n'est pas l'information qui nous interpelle mais l'ordre socio-culturel dans lequel s'inscrivent ces mots. Percevant le mot « arbre » au milieu d'une foule étrangère, nous ne nous disons pas immédiatement « Il est question d'un arbre dans cette discussion... » mais « Ah ! un Français ici... ». Ainsi, « le symbole nous tient dans l'ordre de la reconnaissance et non de la connaissance, de l'interpellation et non de l'information : il est médiateur de notre identité de sujet au sein de ce monde culturel qu'il soulève avec lui et donc il est comme le 'précipité', non conscient[38] ».
La fonction du symbole n'est pas comme celle du signe, elle ne renvoie pas à quelque chose d'autre. Sa fonction première est « d'articuler celui qui l'émet ou le reçoit avec son monde culturel (social, religieux, économique...) et ainsi de l'identifier comme sujet dans son rapport avec les autres sujets[39]. » Le pacte culturel sort de son sein pour permettre la reconnaissance mutuelle. Le symbole accomplit la « fonction primordiale du langage » : il n'informe pas sur le réel mais « rend le réel parlant ». Il façonne le monde comme réalité signifiante, « en l'arrachant, par mise à distance, à son état brut ». Ainsi, le signe est associé au principe de la valeur, au marché tandis que le symbole est associé au principe du hors-valeur, à l'échange symbolique.
Pour Chauvet, le symbole n'est pas dérivé du signe, comme défendu longtemps par l'Occident et sa « métaphysique du langage-instrument[40] ». Ce n'est pas un signe plus complexe, qui n'affecte « aucunement le corps de la vérité qui demeure toujours le même ». Il n'est pas un simple ornement ajouté à la réalité. À l'inverse, il n'est pas une dégénérescence du langage dans la subjectivité. La symbolisation « ne fait au contraire que déployer la dimension première du langage, sa 'vocation' essentielle[41] ». Nous ne percevons jamais le réel à l'état pur, non signifiant.
Le soleil éclaire, aveugle, envahit, vivifie l'homme. Il révèle son monde et règne sur lui. Ce qu'est le soleil est lié à l'existence humaine. Quand Malachie annonce le lever du soleil de justice, la venue du Messie, il n'établit pas le soleil comme un signe, il ne se contente pas d'un simple « comme ». Il reconnaît et dévoile plutôt la plus haute manifestation du réel du soleil, ce qu'il est en relation à l'homme. L'Arbre de Vie était et sera la plus signifiante expression du réel de l'arbre. Il est porteur de fruit, et inséparable de ses feuilles lorsqu'il perdure sous la saison qui lui est propice.
Le symbole n'est donc pas opposé au réel. Il « touche au plus réel de nous-mêmes et de notre monde. Il nous touche au vif[42]. » Cette proximité explique le langage du corps, prenant le relais à l'absence de mots. Dans le deuil par exemple. L'impuissance et inconvenance des mots doivent être remplacés par « la grâce du geste symbolique[43] ».
Un double langage
Tout discours a deux versants. Le premier est symbolique, il est « langage de reconnaissance, fondateur d'identité pour les groupes et les individus, et opérateur de cohésion (réussie ou non) entre les sujets au sein de leur monde culturel[44] ». Le mythe est le meilleur représentant de cette partie du langage. Maniant les codes socio-culturels d'un groupe, il établit le « langage fondateur qui permet à celui-ci de se reconnaître, de s'identifier, de se trouver une place signifiante sous le soleil, et qui fait des individus des sujets d'un 'nous' social commun : tous s'y retrouvent ».
Le second versant est celui du signe, il est « langage de connaissance » qui donne des informations et des jugements. Ce langage trouve son apogée dans le discours scientifique qui ne veut rien d'autre que la connaissance objective. L'homme ne doit ainsi pas se dresser sur son chemin, le sujet doit s'effacer. Mais c’est un fantasme. Nul ne peut se détacher de son discours « objectif », pas même l'homme scientifique qui, lui aussi, cherche « à être reconnu par ses 'pairs', à se trouver une place parmi les autres hommes, à donner sens humain à sa recherche ». Il cherche ainsi à se détacher de ce qui est trop commun, pour s'élever socialement. Bourdieu le signale, l'homme cherche le « profit symbolique » au-delà de la simple communication et peut ainsi se constituer un « capital symbolique », la reconnaissance qu'il peut obtenir d'un groupe.
Notre quotidien se retrouve entre le symbole et le signe. Parler des choses banales, parler pour ne rien dire, c’est déjà agir symboliquement. Par cette expression en surface, l'homme manifeste quelque chose de plus profond, il montre qu'il bon pour lui de parler à un autre. « La communication a valeur pour elle-même ; c'est une reconnaissance sociale de 'présence' qui est ici revendiquée[45] ». En dehors du langage parlé, le quotidien continue de s'exprimer par une quantité de symboles. La même bougie peut nous servir à parfumer l'intérieur ou à compter les semaines de l'Avent. La même fleur peut pleurer un défunt ou encenser l'amour. Un pain peut se trouver à la table de notre foyer pour nourrir nos corps ou être partagé à la table du Roi pour combler nos âmes. « Nos journées sont remplies de telles lectures symboliques : ça ne cesse de parler en nous ; constamment, et sans y penser le plus souvent, ça noue des liens entre notre monde et celui des autres, ça revendique pour nous une place signifiante, ça demande une reconnaissance de 'qui je suis pour toi, qui tu es pour moi[46]'. »
Si le discours purement informatif n'existe pas, à l'inverse, aucun discours n'est purement symbolique. Une connaissance préalable est requise pour que le symbole puisse émerger et se révéler. Les souliers de Van Gogh ne peuvent produire leur effet symbolique si nous ignorons ce que sont des chaussures, leur utilisation ordinaire et la vie d'une paysanne.
L'expérience symbolique ne se suffit donc pas à elle-même. Il n'est de symbole que tendu vers un discours de connaissance, discours de vérité qui est la prétention de tout langage. Un symbole dont on ne pourrait rien dire se dissoudrait dans l’imaginaire[47].
Le symbole, performatif
Chauvet imagine une mission lors de la dernière guerre dans laquelle deux agents secrets qui ne se connaissent pas doivent collaborer. Inspiré par la pratique antique du symbole, le service de renseignement leur confie à chacun une moitié d'un même billet. Cet exemple permet d'illustrer six traits de l'acte de symbolisation. Tout d'abord, « c'est un acte d'ajointement des deux morceaux du billet. Le symbole n'existe qu'en acte[48]. » Il n'est pas question de rester dans le domaine des « idées » mais de faire, par un geste ou non. Plus évident encore, les deux moitiés du symbole sont distinctes. En effet, « on ne symbolise que des éléments distincts ». La valeur de chacun de ces morceaux se trouve seulement dans son rapport à l'autre. Indépendamment de l'autre, une moitié n'a pas de signification définie, de valeur stable. D'ailleurs, ce symbole est hors-valeur, il peut tout aussi bien fonctionner avec un billet de 10 francs qu'avec un billet de 100 francs. Ce ne sont ni la valeur marchande, ni la valeur d'usage qui définissent l'efficacité du symbole mais l'échange entre les sujets. Enfin, l'acte de symbolisation est simultanément révélateur et opérateur. Il révèle l'identité des sujets, il leur permet de se reconnaître comme partenaires. Il est aussi opérateur : « en se reconnaissant comme partenaires, ils sont liés ensemble en un 'nous' commun, soumis aux mêmes risques d'être faits prisonniers et aux mêmes dangers de mort. Le symbole est opérateur d'alliance en étant révélateur d'identité[49]. »
Il y a ainsi une efficacité du symbole, « une efficacité qui touche au réel même ». Ce réel n'est toujours pas le réel brut, immaculé de toute signification. Non, le symbole est efficace sur un réel déjà signifiant, déjà parlant. Un réel déjà façonné par le culturel. C'est là que s'accomplit « la vocation essentielle du langage : effectuer l'alliance où les sujets peuvent advenir et se reconnaître comme tels au sein de leur monde ». Pour Chauvet, cette efficacité s'apparente à celle des actes de langage de John Langshaw Austin. Un acte de langage est la mise en œuvre de la langue. Il peut être de type locutoire, illocutoire ou perlocutoire. Un acte locutoire s'accomplit dès lors que l'on dit quelque chose. L'illocutoire s'accomplit en disant quelque chose, il se fonde sur le sens communiqué. Enfin, le perlocutoire s'accomplit par le fait de dire quelque chose, il est l'effet extérieur produit.
L'illocutoire suit toujours le locutoire. Il accompagne nos actes de langage quotidiens et peut relever du performatif pur, où l'on perçoit sans peine que le simple fait de prononcer change la position des sujets : « je te jure »; « je te prends pour épouse ». Il peut aussi se diriger vers l'autre pôle plus banal : « il fait beau ce matin ». Ce dernier exemple semble purement informatif « mais l'information ici transmise est tellement évidente que, sous peine de prendre l'autre pour un débile mental, c'est en fait autre chose qui se donne à entendre, à savoir : la demande pure et simple de nouer un lien avec quelqu'un. Cette demande de l'autre, tellement codée et déguisée que nous y répondons de manière quasiment automatique sans jamais la penser comme telle, n'est pas du performatif, mais se situe pourtant dans le sillage de celui-ci[50].
L'acte illocutoire est conventionnel. Il ne peut s'exprimer que dans certaines conditions — « notamment l'existence d'une procédure reconnue, son exécution correcte, la légitimité des agents, des lieux, des moments[51]... ». Le « je te prends comme épouse » ne peut se réaliser que dans le cadre d'une alliance entre mon épouse et moi, reconnue par l'institution mise en place. Une identification et une reconnaissance par un monde socio-culturel s'opèrent. L'illocutoire produit une efficacité symbolique, « une transformation des rapports entre les sujets sous l'instance du Tiers social (la loi) auquel ils se réfèrent nécessairement[52] ».
Épilogue
Cette efficacité symbolique se retrouve dans les rites des religions traditionnelles. Pour Bourdieu, le rite « agit sur le réel en agissant sur les représentations du réel[53] ». Il se met en scène dans un cadre social et culturel pour être efficace. Pour Maritain, le rite fait appel « à quelque puissance cosmique conduisant à bonne fin le désir de l'homme, appel qui suppose lui-même une connivence, une complicité dans les choses[54] ». Mais cet appel n'est pas une simple demande, il s'incarne dans des symboles. Dans les rituels, « l’homme n'esquisse pas seulement un geste causal, il fait signe » à des éléments cosmiques semi-personnels.
Le mystère de la réalité est approché par le mystère du symbole. Mais dans les rituels, c'est le faire de l'homme qui se manifeste avant tout. L'absence qu'il perçoit doit être comblée et c'est lui qui s'en charge. L'absence qu'il perçoit doit être comblée et c'est lui qui en prend la responsabilité. Le « monde lointain, absent, presque défunt » trahi par Baudelaire dans La Chevelure doit être rendu proche, présent, vivant. Par cette performativité forcée, l'homme fait taire la grâce. Il se rapproche d'une logique du signe, du monde du marché.
Mais si le mystère s'était incarné ? « Dans cette hypothèse selon laquelle le mystère qui se profile au-delà de l'horizon de l'homme a franchi la ligne de l'arcane et a pénétré le trajet de l'homme, nous sommes confrontés à un changement radical entre cette forme ‘religieuse’ et toute autre tentative humaine de forger une relation avec l’inconnu[55]. » En effet, si le mystère est venu, nous n'avons pas à agir face à l'absent mais à rencontrer le présent. Jean Borella appuie cette réalité: « Il n'y a donc pas deux présences, l'une réelle, ailleurs, et l'autre irréelle, ici et en figure; car il ne peut y en avoir qu'une et une seule, qui, en vérité, est toujours là : c'est nous qui lui sommes absents, et c'est nous qui lui sommes rendus présents par la médiation du symbole qui est, en lui-même, une 'vue'...sur la réalité archétypale[56]. » Nous sommes rendus présents dans l'ordre socio-culturel de celui qui se présente à nous.
Le monde dans lequel nous sommes prend alors tout son sens, il est le cadre dans lequel s'effectue une alliance. Le monde nous est révélé comme parlant, dans un langage que nous percevons au milieu du brouhaha cosmique. Le discours sort de la confusion et fait éclater sa clarté. Baudelaire encore :
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens[57].
Les forêts de symboles du poète nous regardaient jusqu'ici avec des regards familiers. Elles savaient que nous pouvions apporter l'autre moitié du symbole. Mais elles voient passer notre indifférence, cultivée par le culte de la fonctionnalité, de l'utile. En effet, l'intentionnel nous échappe, nous fuyons la signification du réel. C'est pourtant en percevant que le réel est intentionnel que nous réalisons qu'un « pacte fut scellé et qu'il demeure en vigueur[58] ». Pour connaître cette signification personnelle, il nous faut « faire confiance à la tradition (la parole des Anciens) qui nous en livre le savoir. » Celui qui a conféré cette signification à la réalité l'a gracieusement révélée à ceux qui entrent en alliance avec lui. Par la suite, ce savoir est transmis aux générations suivantes qui pourront aussi se présenter avec leur propre morceau du symbole.
Dans la réunion du symbole, nous devenons alors de vrais sujets, parties prenantes du monde, du vrai. Notre finitude se brise. « L'anneau du monde corporel a toujours tendance, sous nos yeux, à se clore sur lui-même et à nous enfermer en lui. Chaque symbole sacré est le lieu où cet anneau se rouvre, révèle sa brisure et nous offre délivrance de la menaçante finitude[59]. » L'homme peut alors s'exprimer dans ce qu'il est réellement. Dans cette alliance, nous reconnaissons tous ses participants. La reconnaissance mutuelle s'opère pour nous rapprocher les uns des autres. Nous sommes frères et sœurs. Fils et filles.
Illustration de couverture : Ambrosius Bosschaert l'Ancien, Nature morte de fleurs, huile sur cuivre, 1614 (Los Angeles, J. Paul Getty Museum).
[1] Louis-Marie Chauvet, Symbole et Sacrement: Une Relecture Sacramentelle de l’existence Chrétienne, Cogitatio Fidei 144 (Paris : Cerf, 1987), 89-90.
[2] Ibid., 90.
[3] Ibid., 91.
[4] Ibid., 92.
[5] Ibid., 94.
[6] Ibid., 95.
[7] Ibid., 97.
[8] Ibid., 98.
[9] Ibid., 99.
[10] Ibid., 100.
[11] Ibid., 101.
[12] Ibid., 102.
[13] Ibid., 104.
[14] Ibid.
[15] Ibid., 105.
[16] Ibid., 106.
[17] Marcel Mauss, « Essais sur le don » (1923), 162 dans Sociologie et anthropologie ; cité dans Chauvet, Symbole et sacrement, 107.
[18] Symbole et sacrement, 107.
[19] Ibid., 107-108.
[20] Ibid., 108.
[21] Ibid.
[22] Ibid, 109.
[23] Ibid, 110.
[24] Ibid, 111.
[25] Ibid, 112.
[26] Ibid, 113.
[27] Ibid, 114.
[28] Ibid, 118.
[29] Ibid, 118.
[30] Jean Borella, Histoire et théorie du symbole (Paris : l’Harmattan, 2015), 23.
[31] Régis Debray, Vie et mort de l’image: une histoire du regard en Occident (Paris : Gallimard, 1992), 82.
[32] Chauvet, Symbole et Sacrement, 120-121.
[33] Ibid., 121.
[34] Ibid., 122.
[35] Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, 47-48.
[36] Chauvet, Symbole et Sacrement, 125-126.
[37] Ibid., 126.
[38] Ibid., 127.
[39] Ibid., 128.
[40] Ibid., 129.
[41] Ibid., 130.
[42] Ibid., 130-131.
[43] Ibid., 131.
[44] Ibid., 132.
[45] Ibid., 133.
[46] Ibid., 133-134.
[47] Ibid., 135.
[48] Ibid., 136.
[49] Ibid., 137.
[50] Ibid., 139.
[51] Ibid., 141.
[52] Ibid., 142.
[53] Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, 124, cité dans Symbole et sacrement, 146.
[54] Jacques Maritain, « Signe et Symbole, » Revue Thomiste XLIV (1938) : 314.
[55] Luigi Giussani, At the Origin of the Christian Claim (Montreal ; Buffalo : McGill-Queen’s University Press, 1998), 30.
[56] Jean Borella, Histoire et théorie du symbole, 80.
[57] Charles Baudelaire, « Correspondances », Les Fleurs du Mal.
[58] Jean Borella, Histoire et théorie du symbole, 88.
[59] Ibid., 87.
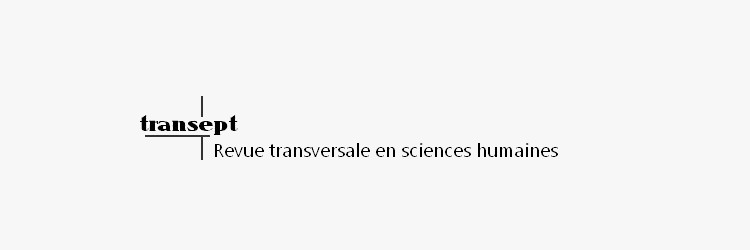



Commentaires
Enregistrer un commentaire